L’étape cruciale du séchage dans la transformation de la cerise de café
La transformation de la cerise de café est un art minutieux, où chaque étape influence la qualité finale du café que nous dégustons. Parmi ces étapes, le séchage joue un rôle fondamental. Après la récolte, les grains de café sont encore humides, parfois imbibés d’eau à plus de 50%. Sans un séchage approprié, ils risquent de se détériorer rapidement, perdant ainsi leurs qualités organoleptiques et leur potentiel aromatique.
Le séchage a pour but principal de réduire cette humidité à un niveau stable, généralement autour de 10 à 12 %, afin d'assurer une bonne conservation du grain vert. Mais cette étape ne se limite pas à une simple perte d’eau ; c’est aussi une phase délicate où les réactions chimiques internes des grains se poursuivent, contribuant à façonner les arômes et les saveurs caractéristiques du café. En effet, un séchage trop rapide, trop lent ou mal contrôlé peut causer des fermentations indésirables, des goûts désagréables ou encore des moisissures qui altèrent irrémédiablement le café.

Les méthodes traditionnelles et modernes de séchage
Dans la plupart des pays producteurs, le séchage au soleil reste la méthode la plus répandue. Après avoir été traités selon le procédé choisi — que ce soit lavé, naturel ou honey — les grains sont étalés en couches fines sur des surfaces adaptées, comme des patios en ciment ou des tables en bois surélevées. Le café est ainsi exposé aux rayons du soleil, et les grains doivent être retournés régulièrement pour assurer un séchage homogène et éviter la prolifération de moisissures. Cette méthode demande beaucoup d’attention et une surveillance constante, car le temps de séchage peut varier de plusieurs jours à deux semaines, selon les conditions climatiques. Un climat chaud et sec favorisera un séchage optimal, tandis que l’humidité ou la pluie peuvent poser de sérieux problèmes.
Face à ces contraintes naturelles, les séchoirs mécaniques sont de plus en plus utilisés, notamment dans les zones où la météo est capricieuse ou pour les grandes exploitations cherchant à accélérer le processus. Ces équipements permettent de contrôler précisément la température et la circulation d’air, offrant une uniformité et une rapidité de séchage que le soleil ne peut garantir. Cependant, cette méthode présente aussi ses risques : une température trop élevée peut cuire le grain, en altérant ses composés aromatiques et en durcissant la structure du grain, ce qui peut nuire à la torréfaction et au goût final. Par conséquent, même en séchage mécanique, la maîtrise technique et l’expérience restent essentielles.
Certains producteurs combinent ces deux approches, en commençant par un séchage naturel au soleil, puis en terminant le processus avec un séchage mécanique pour garantir une humidité stable, surtout lorsque la météo devient défavorable. Cette méthode mixte permet de bénéficier à la fois des qualités aromatiques développées par le séchage lent au soleil et de la rapidité et la sécurité du séchage industriel.
L’influence de la variété : Arabica versus Robusta
Le type de café joue également un rôle dans la manière dont le séchage doit être mené. L’Arabica, souvent considéré comme la variété de haute qualité, possède des grains plus tendres et délicats. Sa composition chimique fine nécessite un séchage particulièrement soigné afin de préserver ses arômes floraux et fruités. Une mauvaise gestion de cette étape peut rapidement entraîner une perte de complexité aromatique ou introduire des défauts comme des goûts de fermentation excessive.
À l’inverse, le Robusta est une variété plus résistante, avec des grains plus durs et une teneur initiale en humidité souvent plus élevée. Cela lui permet de supporter un séchage un peu plus rapide ou énergique sans autant compromettre sa qualité. Toutefois, un séchage trop intense peut accentuer l’amertume et le côté âpre du Robusta, souvent déjà prononcés. Par ailleurs, il est plus fréquent que le Robusta soit séché par des méthodes mécaniques, notamment en raison de son usage souvent plus industriel et d’une moindre valorisation sensorielle par rapport à l’Arabica.
Les précautions pour un séchage réussi
Le séchage du café demande une attention particulière. Il est essentiel de surveiller quotidiennement l’humidité des grains, souvent grâce à des mesures précises à l’aide d’hygromètres ou par des tests simples à l’œil et au toucher. Le retournement fréquent des grains garantit une exposition uniforme au soleil ou à l’air chaud, évitant la formation de zones trop humides ou la prolifération de champignons.
La température doit être surveillée attentivement. Dans le cas du séchage au soleil, elle dépend des conditions naturelles, tandis que dans les séchoirs mécaniques, elle est réglée autour de 30 à 35 °C. Des températures plus élevées peuvent accélérer le processus, mais au risque de « cuire » le grain et d’amoindrir la qualité. Un séchage trop rapide peut également provoquer des fissures dans le grain, ce qui nuit à la qualité lors de la torréfaction.
Enfin, dès que le taux d’humidité atteint le niveau cible, les grains doivent être stockés dans des conditions idéales : dans des sacs en toile ou en jute, à l’abri de l’humidité et de la chaleur excessive, et dans des espaces bien ventilés. Ce stockage temporaire avant la torréfaction est crucial pour préserver les qualités acquises durant tout le processus de transformation.
Conclusion
L’étape du séchage dans la transformation de la cerise de café est bien plus qu’une simple phase technique. Elle est au cœur du développement des qualités sensorielles du café, tout en assurant sa conservation sur le long terme. Qu’il s’agisse d’Arabica ou de Robusta, la maîtrise du séchage, que ce soit par des méthodes traditionnelles au soleil ou par des techniques mécaniques modernes, est indispensable pour garantir un café vert de haute qualité. Cette étape demande patience, rigueur et savoir-faire, des éléments essentiels pour offrir au consommateur final un café à la fois aromatique, équilibré et préservé.
Sources :
- Worku, M., & Bongers, F. (2020). Coffee Processing: Drying and Its Effects on Coffee Quality. International Journal of Food Science, 2020. https://doi.org/10.1155/2020/1234567
- Illy, A., & Viani, R. (2005). Espresso Coffee: The Science of Quality (2nd ed.). Academic Press.
- ICO (International Coffee Organization). (2023). Coffee Development Report 2023. https://www.ico.org/documents/cy2023-24/icc-124-9e-coffee-development-report-2023.pdf
- Rao, N. Z., & Fuller, M. (2018). Coffee Chemistry and Quality. In Coffee: Production, Quality and Chemistry (pp. 45–73). Elsevier.
- Moreno, R., & Giraldo, L. (2017). Effect of drying methods on the quality of Arabica coffee. Food Science and Technology, 37(3), 414-421. https://doi.org/10.1590/1678-457X.16017
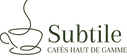
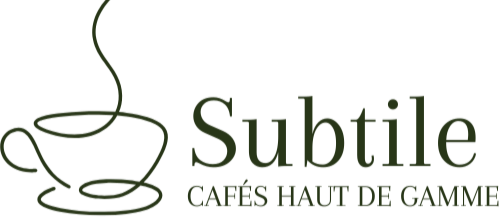
0 commentaire